 |
| "J'balance pas, j'évoque" (Danny Carrel, in Le pacha) |
Selon Dominique Maingueneau, « Trouver sa place dans l’enceinte philosophique : penseurs, gestionnaires, passeurs », Argumentation et
Analyse du Discours 22 | 2019,
pp. 6-12) :
" Le sens du terme « philosophe » a varié selon les époques. Ceux qu’on catégorise aujourd’hui comme tels sont censés appartenir à un domaine ancré dans le monde universitaire qu’on s’attache à bien distinguer d’autres : la littérature, le journalisme, la politique, la science… L’usage courant appelle « philosophes » tous les spécialistes de philosophie, sans tenir compte d’une hiérarchie dont Alain Badiou se fait l’écho au début de son Manifeste pour la philosophie en opposant une poignée de « philosophes » à une population moins prestigieuse de « commentateurs », d’« érudits », et d’« essayistes » : Les philosophes vivants, en France aujourd’hui, il n’y en a pas beaucoup, quoiqu’il y en ait plus qu’ailleurs, sans doute. Disons qu’on les compte sans peine sur les dix doigts. Oui, une petite dizaine de philosophes, si l’on entend par là ceux qui proposent pour notre temps des énoncés singuliers, identifiables, et si, par conséquent, on ignore les commentateurs, les indispensables érudits et les vains essayistes (1989 : 7). Badiou prend ici acte d’un paradoxe : alors que la philosophie est communément conçue comme une activité qui élabore des pensées identifiables, qui se positionnent dans le champ philosophique, la plupart de ceux qu’on appelle « philosophes » se consacrent à d’autres tâches, nécessaires mais moins prestigieuses. Les « penseurs » se distinguent ainsi des « gestionnaires », beaucoup plus nombreux, qui se consacrent à l’étude des positionnements déjà établis ou qui contribuent à les établir. Ces termes de « penseur » et de « gestionnaire » sont à certains égards insatisfaisants. « Penseur » a en effet un sens plus restreint que dans l’usage courant ; pour éviter toute confusion, nous le mettons ici entre guillemets. Quant à « gestionnaire », il ne doit pas être pris péjorativement, ni associé au monde de l’entreprise. Garant d’un ordre de la philosophie, le gestionnaire exerce deux fonctions complémentaires, qu’il mêle selon des proportions variables dans les multiples genres de discours qu’il mobilise : celle de cartographe et celle d’« animateur ». En tant que « cartographe », il organise l’archive philosophique : il y distingue des régions et y dispose des balises, la constituant en un espace pensable, partageable et où il est possible de circuler. En tant qu’« animateur », il se voit confier par l’institution la tâche de donner sens aux textes, d’en montrer l’actualité. Dans ce cas, son attention se porte en général sur un auteur ou une oeuvre. Sera par exemple cartographe l’auteur d’une présentation synoptique de tel courant de la philosophie grecque, et animateur celui qui proposera une « lecture neuve » de Hume ou de Husserl. Si les « penseurs » doivent valider leur appartenance à l’espace philosophique en désignant les manques des positionnements existants pour assoir le leur, les gestionnaires multiplient les relations entre les positionnements, à travers deux démarches complémentaires. La première les amène à découper des régions, à tracer des frontières entre les époques, les auteurs, les écoles, les courants, les genres, les disciplines… La seconde les amène à brouiller toutes les frontières, à circuler su l’ensemble de l’espace : c’est le cas en particulier des entreprises d’ordre lexicographique, où l’on extrait des concepts – unités lexicales ou suites d’unités figées –, en associant dans une même entrée des termes issus des auteurs et des époques les plus divers. Pour la France on peut songer aux ouvrages collectifs dirigés par André Lalande (Vocabulaire critique et technique de la philosophie) ou Sylvain Auroux (Les notions philosophiques (Auroux dir. 1998). A côté des travaux lexicographiques, on peut aussi évoquer les entreprises qui visent à présenter les diverses facettes d’une « grande question » en groupant des textes ou en articulant des résumés de doctrines éloignées d’un point de vue géographique, intellectuel ou temporel. En France, par exemple, la collection « Corpus » de GF Flammarion propose des anthologies de textes philosophiques commentés, précédées d’une solide introduction, sur des thèmes aussi divers que la mort, la justice, la liberté, l’illusion, le pouvoir… Il existe aussi des ouvrages ou des chapitres d’ouvrages qui font de véritables cours sur de telles questions. Ainsi Pascal Engel (1995) qui pour traiter des « croyances » convoque Hume, Kant, Platon, Pascal, Descartes, Reid, Peirce, Wittgenstein… Ces deux démarches des gestionnaires, l’une qui divise, l’autre qui rassemble, ne s’opposent qu’en apparence. La première ne peut découper l’espace philosophique qu’en renforçant sa frontière avec un extérieur et en faisant de chaque région une unité spécifique. Quant à la seconde, elle n’unifie que pour mieux faire apparaître des lignes de fracture : les entrées du dictionnaire regroupent des emplois divergents, les ouvrages de synthèse sur les « grandes questions » philosophiques mettent en scène des différends. "
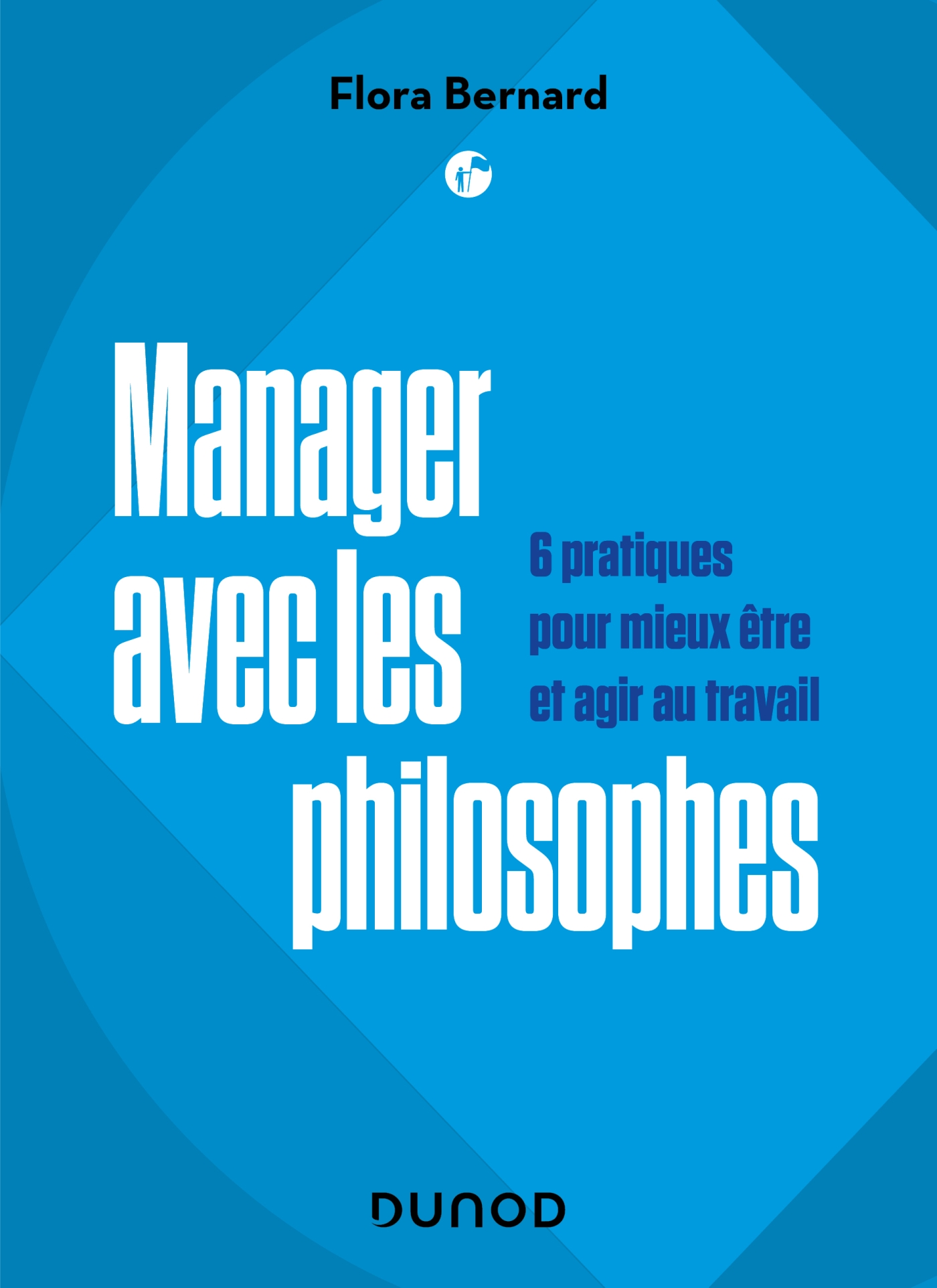
selon Patrice Maniglier, La philosophie qui se fait, cerf, 2019 p. 42 :
 |
| le flic et la grisette (Quai des Orfèvres, Clouzot) |
| le flic et l'indic |
sur cette querelle voir
https://www.liberation.fr/debats/2016/11/24/trump-abaisse-le-debat-jusqu-en-france_1530714/
https://www.liberation.fr/debats/2016/11/29/consensus-n-est-pas-verite_1531752/
http://www.francetvinfo.fr/politique/la-verite-importe-t-elle-encore-en-politique_1925183.html
Ce n'est certes pas incompatible d'être à la fois gestionnaire et flic.
