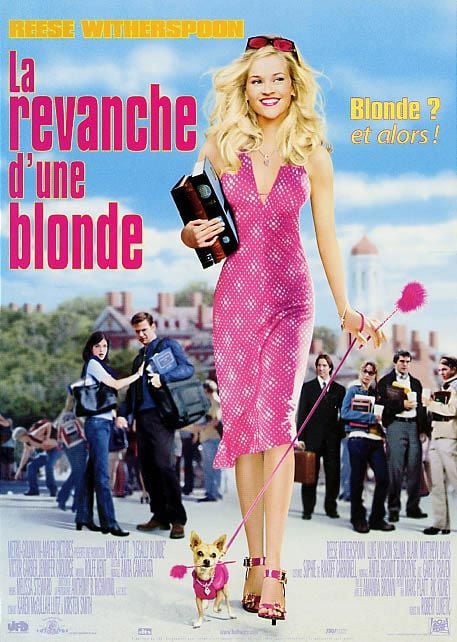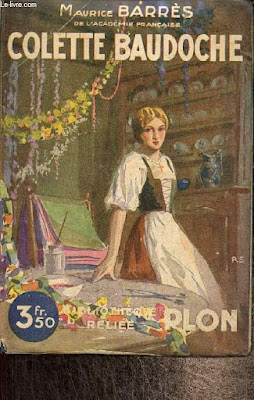"Le cahier vert de M. Julien Benda est remarquable à plus d'un titre.
D'abord, vit-on jamais si longue préface à de si courtes histoires ? On
songe à ces repas russes où le hors-d'œuvre est l'essentiel. Dans sa
préface, M. Julien Benda interroge son cœur, qu'ont ému les critiques
des Amorandes :
parce qu'il est philosophe, on ne veut pas qu'il soit romancier. M.
Julien Benda, qui a des idées, a bien raison de croire qu'il a aussi le
droit de les incarner. Mais ses incarnations sont-elles des romans ? On
n'ose rappeler à un philosophe qu'il faut d'abord définir les termes de
la discussion, si l'on veut éviter une querelle de mots. Peut-on définir
le roman, l'incarnation des idées ? Nous ne le pensons pas. Le roman
crée d'abord des êtres qui vivent, et, si du conflit de leurs passions,
se dégagent des idées générales touchant les caractères et les mœurs, il
faut que ce soit à l'insu du romancier – ou que, du moins, les lecteurs
puissent croire que c'est à son insu. Les êtres que nous ayons créés il
importe qu'ils nous dominent et s'imposent à nous ; sinon nous
substituerons à la vraie destinée de nos héros notre caprice et notre
passion. Le romancier doit être pareil au Dieu de Malebranche, qui n'intervient pas par des volontés particulières. Ainsi, Dostoïevski est à chaque instant débordé par ses personnages, qui l'entraînent où il ne voudrait pas aller.
Cela ne veut pas dire que nous condamnions l'art de M. Julien Benda. Mais faut-il appeler roman ces récits ? Pour la Croix de Roses, conte philosophique nous paraîtrait mieux convenir — ou, si M. Benda y tient, roman philosophique.
"La nature n'a pas besoin que votre partenaire vous plaise. Notre
excitation seule est nécessaire pour l'amour. La vôtre n'est qu'un
luxe." Cela est dit dans le silence de la nuit, sous les baisers de sa
maîtresse, par le héros de M. Julien Benda. Quelle alcôve entendit
jamais de tels accents ? Conte philosophique, vous dis-je. Mais comme
les idées de M. Benda sont fort ingénieuses et excitantes, nous ne nous
plaignons pas. Voyons-les d'un peu près. La Croix de Roses est celle où
se crucifie le malheureux homme dont la destinée est d'être amant. M.
Benda nous fait de son martyre une peinture qui nous tire les larmes.
Les femmes l'aiment, mais elles le méprisent ; il est un objet à leur
usage et détourné par elles de toute grande œuvre. Cependant, il n'a
jamais la femme tout entière, celle que le- mari, même trompé, possède.
Il ne connaît d'elle que le petit animal luxueux et qui aime qu'on le
caresse. Il l'ignore humiliée, souffrante, et quand il fout la secourir,
et quand elle donne la vie. Tout cela est vrai, d'une vérité relative.
Ce cahier vert est un livre consolant à l'usage des personnes pas
aimées. Mais les idées perdent bien de leur vérité en s'incarnant, C'est
l'inconvénient des contes philosophiques en général que si les idées y
sont quelquefois vraies les personnages y sont presque toujours faux.
Et
d'abord M. Benda nous montre une jeune femme qui se partage entre
l'homme qui lui plaît, mais qu'elle dédaigne, et un grand physiologiste
qu'elle admire. Et, selon l'auteur, c'est le grand physiologiste qui a
la meilleure part. Il ne s'agit pas ici de la "femme parfaite", telle
que l'a conçoit Barrés, quand il écrit à un endroit du Jardin de Bérénice :"Une
femme parfaite se choisirait un amant plein d'ardeur dans l'élite de la
cavalerie française et, pour l'aimer d'amour, un prêtre austère comme
notre divin Lacordaire..." Certes, nous imaginons une dame cérébrale, de
celles qu'enchantent les Dialogues d'Eleuthère,
s'essayant à cette perfection. Mais, dans aucun cas, si elle adore son
amant, elle n'ira par amour de la science caresser chaque samedi le
grand physiologiste. Lui faire la lecture, tout au plus.
Nous ne
croyons pas non plus beaucoup à cet amant crucifié sur des roses, à ce
condamné aux travaux forcés de l'amour. Il nous semble que M. Benda a
été trop impressionné par le théâtre de Porto-Riche. Il répète que ce
sont toujours les mêmes qui sont amants, et jusqu'à l'âge le plus
avancé. Nous ne pensons pas que ce soit aussi simple. Certes, rien n'est
si commun que l'homme qui n'est pas né amant. Mais l'amant jusqu'à
l'âge le plus avancé est un type fort rare ailleurs que sur les
planches. Porto-Riche et, à sa suite, tous les fournisseurs habituels du
Boulevard, aiment faire triompher le quinquagénaire, pour des raisons
plus humbles qu'ils ne le croient eux-mêmes : peut-être parce qu'ils ont
passé cet âge, on parce qu'il faut que, le rôle aille à Guitry, ou
encore parce qu'une salle est toujours pleine de vieux messieurs qui ont
besoin qu'on les rassure. Le vrai est qu'il y a un âge pour être amant
et un autre pour être cocu, et que la justice immanente distribue
équitablement aux deux extrémités de notre vie les grâces requises pour
ces deux états.
Enfin, au risque de rendre vaincs les consolations
que prodigue M. Benda à ceux qui ne sont pas nés amants, reconnaissons
qu'il n'est aucune de leurs joies matrimoniales que ne puisse goûter
l'homme-à-femmes lorsqu'il se résout à se fixer. La moindre liaison
suffit pour qu'il connaisse le corps de son amie "dans toute sa
condition humaine, non pas seulement dans ses triomphes, mais dans ses
tristesses, dans ses défaites..." Bref, s'il y a des hommes qui ne
connaîtront jamais la joie des amants, il n'est pas d'amant qui, une
fois au moins dans sa carrière, ne connaisse la grandeur et la servitude
conjugale ; un collage y suffit. L'homme qui a eu la plus brillante
destinée amoureuse est sûr, tôt ou tard, au moins une fois, d'aimer et
de n'être pas aimé.
N'empêche qu'il y a beaucoup de sagesse et de
lucidité dans les aphorismes de M. Benda touchant le servage des amants.
L'homme sage, après avoir lu son livre, reconnaîtra qu'il faut se
déprendre de la Croix de Roses. Mais c'est un effort que tout le monde n'a pas
l'occasion de tenter. Car on ne peut renoncer qu'à ce qu'on a, se dit
l'homme qui n'est pas né amant. Du moins, ce petit livre acide et
contracté le fournira de raisons pour se glorifier de l'indifférence des
femmes à son égard et pour être bien content de sa part ici-bas qui,
d'un point de vue bas, n'est peut-être pas la meilleure, mais dont il
est bien sûr qu'elle ne lui sera pas ôtée.
François MAURIAC.
les nouvelles littéraires, 17/ 04/2023
https://mauriac-en-ligne.huma-num.fr/items/show/514
Mauriac a parfaitement raison. Plus tard, Benda, dans La jeunesse d'un clerc, avouera que le roman fut son grand échec, et qu'il ne parvint jamais à animer des idées abstraites. Mais pourquoi chercher à faire cela? Hegel écrivit le roman de la conscience, Sartre celui de l'être, Merleau-Ponty celui du visuel, qui sont assez réussis dans le genre