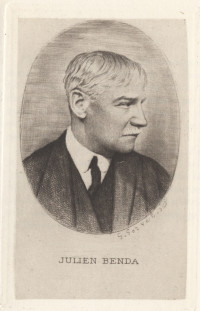|
| La Justice spirituelle et la vengeance intellectuelle poursuivant le Crime contre l'Esprit |
(On m’a dit qu’Ange Scalpel, juriste, ne
semblait pas avoir manifesté sur ce blog un grand intérêt pour les problèmes
juridiques. Mais j’ai retrouvé dans ses papiers posthumes certains textes comme
celui-ci, qui en témoignent).
Angela Cleps
Après la Seconde Guerre mondiale, on
s’avisa que les causes de la guerre pouvaient avoir été tout autant
intellectuelles et spirituelles que physiques, sociales ou historiques. Ne
fut-ce pas, après tout, le manque d’intelligence de l’état-major français (réputé
pour sa bêtise depuis l’affaire Dreyfus et le Chemin des Dames) qui avait
conduit Gamelin à penser que les Allemands allaient attaquer par la Belgique
comme en 14, et à ne pas écouter le colonel de Gaulle qui prônait l’usage massif des chars ? La
bêtise des Polonais qui avaient conduit leurs lanciers à cheval contre les
chars du Reich dans une charge dérisoire ? La sottise de Chamberlain et la
couardise intellectuelle de Daladier (qui ne manquait cependant pas de
jugement, puisque il était capable d’appeler un con un con) qui avaient conduit
à la capitulation de Munich ? Les idiots de la Grande guerre avaient, il
est vrai, du fait que la victoire contre Guillaume avait été conquise par les
Alliés, relégués au second plan, mais leur présence se faisait toujours sentir,
ne serait-ce que parce que le plus malhonnête intellectuel parmi eux, Philippe
Pétain, venait de faire le « don de sa personne » ( on notera :
mais pas de son intelligence) au pays. Goering, Goebbels, Speer, Himmler ou
Borman était certes plus fins que leur maître, et à bien des égards malins
comme des singes, et ils n’étaient pas dépourvus de Sweckrationalität. Chez les intellectuels, Rosenberg, Heidegger, Schmitt passaient pour
des minus habens face aux grands noms
de l’Allemagne weimarienne comme Mann, Husserl, Jaspers et Cassirer, mais même
des demi-habiles sont habiles. Pendant l’Occupation, les collaborateurs, les
partisans de Vichy ne manquèrent pas de fustiger la sottise du Front populaire,
la nullité des institutions pourries de
la Troisième république, et la connerie des Rad’ soc et du Cartel des gauches.
Les intellectuels fascistes, Mussolini en tête, n’avaient pas démérité en
matière de sottise, de vanité et de vide intellectuel. Mais personne ne pouvait
nier que la Seconde guerre mondiale ne traduise un effondrement des valeurs de
l’esprit et de l’intellect sans
précédent, que des auteurs comme Kraus, Benda, Orwell, Ortega y Gasset ou Musil
avaient parfaitement diagnostiqué avant-guerre, mais sur lequel ils avaient été
incapables de peser (d’ailleurs comment peser sur un effondrement, sinon en
s’effondrant un peu plus avec lui ?). Aussi, quand le tribunal de
Nuremberg commença en 1945 à donner les contours d‘une définition de la notion
de crime contre l’humanité, de grands
juristes internationaux commencèrent à réfléchir à la notion de crime contre l’esprit. Ils étaient
frappés par la limitation mentale et l’absence de sens de l’esprit et des
valeurs non seulement des fascistes et des nazis, mais aussi des communistes, et
de nombre de leurs contemporains. Leur orientation était clairement libérale,
mais ils voyaient aussi combien le libéralisme ne préserve pas de la sottise.
L’idée que des individus puissent particulièrement se rendre coupables de
crimes contre l’esprit leur paraissait sensée. Mais cette idée mit du temps à
faire son chemin. Les marxistes s’y opposaient. D’une part ils jugeaient les
masses opprimées innocentes de tels crimes, et leurs guides communistes
immunisés, et ils condamnaient comme
bourgeoise la conception de l’esprit qui présidait au projet. Mais on leur opposait
des épisodes comme le lyssenkisme, qui n’était pas particulièrement glorieux. Le crétinisme libéral n’était pas en reste. Qui
aurait pu dire, à la contemplation du
maccarthysme, dans des condamnations comme celles d’Alan Turing, que les
valeurs de l’esprit étaient respectées ? Il n’y avait pas que dans le
monde social et historique que des crimes contre l’esprit se commettaient. On
accusait la Raison et les Lumières d’en avoir commis d’énormes en rendant
possible le nazisme, on accusait les marxistes d’en commettre encore plus, et
ces derniers voyaient dans l’idéologie libérale la ruine de l’intellect. Sartre
ne disait- il pas qu’ »un anticommuniste est un chien » ? Plus
tard, de graves offenses à l’esprit se produisirent souvent, avec des livres
comme Le matin des magiciens, ou les
ouvrages de Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie. Plus tard encore, les
méfaits de la French Theory, et les dénonciations salutaires de Sokal et Bricmont,
attirèrent l’attention d’autres crimes de lèse- intellect. Mais il n’y avait
pas que dans le domaine des idées que ces offenses se produisaient. La
littérature – que l’on songe à la cohorte de prix Nobel de littérature qui ont
stupéfié tous ceux qui avaient encore un sens des valeurs de cet art – et les
sciences que l’on songe à la montée de
la fraude dans les laboratoires – n’étaient pas en reste. Ajoutez à cela la
nullité des productions artistiques contemporaines (chiens en plastique et
plugs anaux plantés dans les décors urbains), de l’architecture, qui rendait
les villes inhabitables, du kitsch qui envahit nos habitations, du théâtre, qui
devenait un immense happening, et du
cinéma, où les pires navets étaient portés aux nues. Le pire encore était que
toutes ces œuvres nullissimes étaient jugées admirables, selon le principe qui
veut que les voleurs soient les premiers à recevoir la gloire d’avoir pratiqué
la truanderie. Au lieu de raser les murs, de se terrer dans des trous, les
criminels contre l’esprit non seulement opéraient au grand jour, mais
recevaient tous les honneurs.
On s’attela donc, dès la fin des années
60 du vingtième siècle, à définir un nouveau statut du droit pénal, celui de crime contre l’Esprit. Reprenant les
idées pionnières des juristes sus mentionnés, des spécialistes en droit
international se mirent, inspirés par la cour de la Haye, à définir un statut
pour ce type de crimes, et une commission se créa en vue d’établir un Tribunal
international visant à juger les crimes contre l’Esprit (TICE). Mais on se
heurta immédiatement à des problèmes insolubles. D’abord comment définir ces
types de crimes ? En quoi concernaient-ils l’intellect universel ? Et
comment distinguer des crimes relevant de l’évaluation théorique de ceux qui
relèvent des applications pratiques ? Les offenses à la beauté, comme les
œuvres kitsch ou l’architecture soviétique, étaient-elles des offenses à
l’Esprit ? La musique rock, le rap devaient-ils aussi être condamnés ? Fallait-il condamner un
imbécile juste parce qu’on le jugeait tel et sans qu’il eût beaucoup diffusé
ses idées, ou bien parce qu’il aurait essaimé mais sans que pour autant ses
écrits aient réellement compté dans ses activités politiques ( à supposer
qu’il y en ait eût)? En quoi étaient-ils
des crimes, plutôt que des délits ? Pourquoi devraient-ils être jugés par
une cour internationale et non pas au niveau national ? Quelles
sanctions leur appliquer, et selon quels critères ? Où la Cour dévolue à
ces crimes siégerait-elle ? A la Haye ? A Londres ? A
Oslo ? A Paris ? A Little
Rock ? A Osaka ? A Singapour ? A Sydney ? Aux Iles
Samoa ? Certains marxistes voulaient pendre Milton Friedmann, des
disciples de Aynd Rand voulaient pendre Sartre, des théoriciens du
post-colonialisme entendaient traîner des penseurs universalistes devant le
Tribunal international des crimes intellectuels, des féministes voulaient
inclure des violeurs notoires d’Hollywood dans le lot, et des penseurs libéraux
et conservateurs voulaient traîner Badiou ou Zizek devant la Justice. Un peu
perdu, le comité destiné à constituer un tribunal proposa un programme minimal,
un lieu minimal, et un jury minimal. Il se demanda d’abord s’il devait inclure
dans ses membres les Prix Nobel, mais on réfléchit vite au fait que
ceux-ci n’étaient peut-être pas, à de rares exceptions, les meilleurs juges du
progrès de l’Esprit. Bob Dylan devrait-il juger les atteintes à
l’intelligence ? On se rabattit
alors sur les récipiendaires du Prix Balzan, du Prix Hinamuro de Tokyo,
puis du Prix Holberg, puis du Pulitzer
et du Booker Prize, et le même problème se posa : plus on descendait dans
l’échelle du prestige, moins on avait de chances de trouver des représentants
authentiques du Règne de l’Intellect. Les chefs d’Etat à la retraite, les
Hautes autorités des Universités, et même les dignitaires ecclésiastiques déclinèrent,
de crainte du ridicule. Pour faire bonne mesure on fit appel à de grandes
figures du féminisme et du post-colonialisme, qui refusèrent. Il ne resta plus,
pour composer le jury, mettre en place dans la seule capitale un peu neutre
choisie, l’Andorre, que quelques inconnus.
Ils s’accordèrent sur le fait qu’une œuvre
de mauvaise qualité, bête ou laide, ne pouvait pas compter comme un crime, et
que même des monuments de stupidité ne pouvaient pas valoir à leurs auteurs
plus que la réprobation et le blâme, et non pas des condamnations pénales. On
ne pouvait pas revenir à la censure communiste, à Jdanov, ou à la mise à
l’index vaticane des œuvres non conformes aux canons de la décence
intellectuelle. Des groupes variés, au nom de minorités (ou de majorités)
sexuelles, ethniques, religieuses, ou
politiques, essayèrent bien de s’immiscer dans le Tribunal, afin de faire
avancer leurs programmes moralisateurs,
par exemple en bannissant les peintures blasphématoires contre le Christianisme
ou l’Islam. Divers censeurs voulaient en
profiter pour réintroduire le Spirituel dans l’art – par quoi ils entendaient
le religieux. Mais les juristes du TICE résistèrent à cette intrusion des considérations
morales et religieuses dans le règne de l’Esprit. Ils définirent alors les
crimes contre l’esprit en des termes plus classiques sur la base de la
responsabilité des individus et de leurs actes. On s’attacha alors à pénaliser
le plagiat, la fraude, la filouterie dans le domaine intellectuel et
artistique, plutôt que des crimes indéfinissables, comme la sottise ou l’art
laid. Mais d’une part, aucun de ces crimes et délits ne semblait avoir la
dimension des crimes contre l’humanité, qui restait le modèle ultime de ces
juristes – aucun crime comparable à un génocide n’était commis par un plagiaire
ou un fraudeur en sciences –et d’autre part ces manquements à l’éthique
intellectuelle étaient si nombreux qu’un tribunal de l’Esprit n’aurait jamais
pu les instruire ou les juger tous. Il était bien difficile de trouver des
Milosevic ou des Karadzic de l’Esprit, même si bien des noms de clercs traîtres
venaient spontanément comme candidats à la condamnation. Au mieux, on pouvait
mettre ces gens à l’amende. On essayait de traîner devant le tribunal des TICE
quelques-uns des intellectuels que Sokal et Bricmont avaient attaqués, puis , en réaction, Sokal et
Bricmont eux-mêmes, mais tous furent acquittés. On s’intéressa aux responsabilités collectives,
car après tout la connerie n’est-elle pas de masse ? Ainsi on voulut
comparer la pollution intellectuelle des GAFA , le tombereau de sottise
numérique, à celle des pétroliers dont les navires s’abîmaient régulièrement
sur nos côtes, tuant toute vie alentour. Greta Thunberg déclara même que ses
professeurs avaient ruiné son enfance en ne lui apprenant pas à réciter par
coeur l’Iliade ou l’Eneide. Impressionné par cet argument le TICE, dont les juges
avaient un semblant d’éducation humaniste, accepta même de laisser traîner devant sa
juridiction un enseignant suédois qui avait recommandé à ses élèves la lecture
de Millenium plutôt que celle de
Selma Lagerlöf. Personne n’y vit de crime. La comparaison fit long feu, et les
mauvais professeurs répondant à ce critère furent tous acquittés. Même en
distinguant ceux qui, à travers le monde, n’étaient pas responsables de leur
ignorance de ceux qui étaient responsables de celle des autres, ou qui
l’induisaient, la tâche était titanesque.
Le TICE avait fini par jeter l’éponge. A cela s’ajoutait un argument
financier : allait-on mettre en prison, ou sous bracelet électronique, tous
ces criminels contre l’esprit , même si on parvenait, tels les anciens
nazis, à les traquer et les déférer devant la justice? Les coûts seraient
astronomiques.
Après une dizaine d’années de travail, les
juges du TICE se résignèrent à
démissionner. L’Andorre se consacra à des activités plus lucratives et refusa
d’héberger encore des juristes sans doctrine et sans coupables, et le cours de
l’Esprit, qui souffle, ou non, où il le veut bien, reprit son chemin.